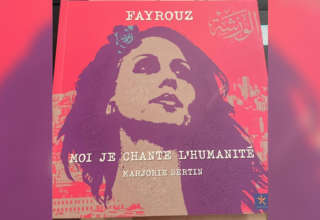«En devenant vision du monde, l’idéologie devient un code universel pour interpréter tous les événements du monde. De proche en proche, la fonction justificatrice [de l’idéologie] contamine l’éthique, la religion et jusqu’à la science » : ainsi s’exprime Paul Ricœur dans un texte où il définit la différence entre idéologie et utopie. Cette sentence nous rappelle à quel danger s’expose l’interprète de tout texte du fait de l’intrusion de l’élément idéologique dans le discours humain. Nous avons essayé la semaine dernière de souligner cet aspect de la pensée de Ricœur, en indiquant que cela correspondait chez lui à une volonté de corriger une faiblesse critique qu’il avait relevée chez Hans-Georg Gadamer, grande figure de l’herméneutique allemande.
A vrai dire, Gadamer n’ignorait pas qu’il y eût des préjugés illégitimes qu’il incombait à l’interprète de relever et de bannir, dans la mesure où ils déformaient la compréhension de l’autre. De son point de vue, la « faiblesse » dont on l’accusait ne remettait pas en question son choix de ce qu’il appelle la « participation par appartenance », c’est-à-dire l’ancrage positif de l’interprète dans l’élément de sa propre histoire et de sa propre tradition comme moyen d’aller à la rencontre de l’autre à travers la découverte de toute œuvre de culture. Pas davantage revenait-il sur son rejet de ce qu’il appelait aussi, par opposition, la «distanciation aliénante». Par quoi il entendait cette distanciation voulue par les nécessités de l’objectivation, et en faveur de laquelle avait milité Wilhelm Dilthey. Aliénante, cette distanciation le serait dans la mesure où elle arrache l’interprète au monde auquel il appartient : ce qui vaut en effet aliénation, au sens premier d’un devenir étranger à soi. Mais il est vrai que le risque que le texte à interpréter eût lui-même un caractère idéologique, et que cela dût induire une prudence dans la façon de l’appréhender – le passage par le filtre de la « critique de l’idéologie » – cela ne figure pas parmi les préoccupations de Gadamer. La grande affaire de ce dernier, c’est de s’émanciper de la « distanciation aliénante ».
Pourtant, comme nous l’avons souligné précédemment, Ricœur va opter pour un retour à la « distanciation aliénante », tout en annonçant qu’il y introduit une « notion positive et productive ». Cette nouvelle forme de distanciation, c’est ce qui va donner lieu à ce qu’il appelle la « voie longue », que nous allons examiner dans les lignes qui suivent et qui va ramener le texte au centre du travail herméneutique, là où on observait jusque-là – et en particulier avec Gadamer -, une sorte de dissolution du texte au profit de l’auteur.
Dans un ouvrage central, et disponible en format de poche – Du texte à l’action -, l’herméneute français présente en une vingtaine de pages sa conception de la « fonction herméneutique de la distanciation ». Il s’agit d’un chapitre d’une grande densité, mais dont l’importance est tout à fait stratégique pour saisir l’originalité de la pensée de Ricœur. Ce passage nous permet également de nous rendre compte à quel point Ricœur était attentif à ce qui se pensait autour de lui à son époque sur le thème de la langue et du texte, en particulier du côté du structuralisme, mais aussi du côté de théories anglo-saxonnes telles que le Speech-Act. De la même façon qu’il sollicitera Marx et Freud pour sa critique de l’idéologie, il fera appel à Saussure, Benveniste et d’autres théoriciens moins connus de nous pour élaborer sa propre conception.
Evénement et signification
Son exposé commence par une distinction entre langue et discours, à l’occasion duquel il va mettre en évidence ce qui est à la fois le premier acte de l’élaboration du texte du point de vue de son auteur, mais ce qui constitue aussi la première dimension de la distanciation du point de vue de l’interprète. C’est-à-dire de la prise de distance vis-à-vis de son propre point de vue en tant qu’il exprime la singularité d’une appartenance culturelle.
Ferdinand de Saussure, dans son Cours de linguistique générale, établit une différence entre langue et parole, ou langue et discours. Toutefois, la linguistique structurale, dont il s’occupe en particulier, ne s’intéresse – et de façon délibérée – qu’à l’un des termes de cette distinction, à savoir la langue, pour se détourner du discours. Or c’est dans le discours qu’on est en présence de ce que Ricœur appelle la « dialectique de l’événement et de la signification », qui est à l’œuvre dans la création de tout texte se donnant ensuite à interpréter. Emile Benveniste, une autre figure bien connue de la linguistique, reprend, dans ses Problèmes de linguistique générale, la distinction saussurienne, mais il ne tourne pas le dos au discours. C’est à lui que l’on doit une seconde distinction, à savoir que si le « signe » est l’unité de base de la langue, la « phrase » est l’unité de base du discours. Il y a donc, inspirée de Benveniste, une « linguistique de la phrase » qui supporte la dialectique de l’événement et du sens. Mais qu’entend-on par événement et quel est son lien avec le sens, se demande Ricœur ?
Ce qui fait que le discours relève de l’événement, explique-t-il, c’est d’abord qu’il a lieu dans le temps. Tandis que le système de la langue, lui, est hors du temps. C’est ensuite qu’il y a un sujet, de sorte qu’on peut toujours poser la question « Qui parle ? ». En outre, le discours se réfère à un « monde qu’il prétend décrire, exprimer ou représenter ». Il y a, dit Ricœur, une venue au langage d’un monde par le moyen du discours. Enfin, c’est par le discours que « des messages sont échangés ». Ce qui suppose qu’avec le discours il y a un autre, un interlocuteur à qui est adressé le propos du discours. Un dialogue peut ainsi être établi.
Venons-en maintenant à la signification, autre « pôle » du discours dans la linguistique de la phrase. Car ce que nous comprenons dans le discours, ce n’est pas l’événement qu’il constitue, mais sa signification qui, souligne Ricœur, demeure !
Il y a du dire, mais qu’est-ce qui est dit ? C’est ici qu’on rencontre la théorie du Speech-Act de J. L. Austin (Quand dire, c’est faire) et de J. R. Searle (Essai de philosophie du langage). La signification se déploie à trois niveaux. Premièrement, celui de la proposition, qui est « l’acte locutionnaire ». On dit quelque chose de quelque chose. Deuxièmement, celui qui renvoie à ce que nous faisons quand nous parlons. On peut constater un état de chose, mais aussi donner un ordre, exprimer un souhait, faire une promesse… C’est chaque fois une action différente. Ce niveau est celui de « l’acte illocutionnaire ». Enfin, troisième niveau, celui de « l’acte perlocutionnaire » qui désigne « ce que nous faisons par le fait que nous parlons ». Il est question ici du discours comme stimulus produisant certains résultats, comme par exemple de provoquer la peur.
Explication-compréhension: l’opposition abolie
C’est à ces trois niveaux que se déploie la signification d’une phrase, de telle sorte qu’on puisse « l’identifier et la ré-identifier » au-delà du moment où elle est prononcée, de telle sorte qu’elle puisse être « transférée » à d’autres sans changer de teneur. Remarquons que, jusqu’ici, la phrase dont nous parlons peut être aussi bien orale qu’écrite. Et que, d’autre part, « l’extériorisation intentionnelle » de la phrase orale, qui rend possible l’inscription de cette dernière dans l’écriture, est « décroissante » à mesure que l’on passe du premier niveau au troisième. La restitution des mimiques et des gestes qui accompagnent le discours oral et qui sont inséparables de sa signification pose en effet des difficultés. Il en va de même pour tout ce qui concerne l’effet escompté et produit par le discours, qui n’est pleinement intelligible qu’au regard d’un certain contexte du moment et que l’inscription dans l’écriture risque d’occulter. Il reste cependant que l’acte de discours, en tant que tel, est porteur de sa signification selon les trois aspects que nous venons d’évoquer et que c’est dans la plénitude de sa signification qu’il devrait en principe être restitué.
Tel est le premier moment de la « distanciation » : nous y avons vu le passage du langage, comme élément de base, au discours comme événement qui produit du sens. Le second moment concerne le passage du discours à l’œuvre, et de la linguistique de la phrase et du Speech-Act aux règles de la composition définissant le « genre littéraire » selon une codification précise. On arrive ici sur le terrain de la « praxis » et de la « techné » littéraires ! Mais aussi du style, qui confère à l’œuvre son individualité, son caractère unique…
C’est par l’unicité de l’œuvre que l’interprète est mis également devant l’unicité d’un auteur. Parvenu à ce stade de son développement, Ricœur fait remarquer que l’auteur auquel il a affaire n’est pas cette intériorité créatrice qui obsède l’herméneutique depuis Schleiermacher, mais qu’il est plutôt à rapprocher de l’artisan qui imprime son « estampille » sur l’ouvrage de ses mains, ou l’artiste qui laisse sa « signature » sur son tableau. Le style ne renvoie pas à un locuteur dont l’âme serait à visiter ou à explorer, mais à un ouvrier qui marque le langage de son travail propre.
Ce qui permet à Ricœur d’affirmer que l’herméneutique est une façon de retrouver le discours dans l’œuvre, dans la spécificité de son genre littéraire – récit, poème, essai… – ainsi que dans l’unicité de son style, et que l’interprétation requise pour le faire ne relève pas seulement de la compréhension, mais aussi et d’abord de l’explication. En effet, il y a, comme nous l’avons vu, une dimension structurale, présente au niveau aussi bien du passage du langage au discours que du passage du discours à l’œuvre… Or cette dimension structurale ne se laisse comprendre que moyennant une explication. Le point est d’importance si on se souvient que l’opposition explication – compréhension est celle sur laquelle Dilthey bâtit en quelque sorte toute son herméneutique : pour Ricœur, cette opposition n’est tout simplement pas pertinente. Il n’y a pas opposition : il y a complémentarité !
Une réalité « plus fondamentale »
Mais une autre nouveauté est celle que Ricœur présente dans la partie qui suit immédiatement dans son texte et qui est intitulée : Le rapport de la parole et de l’écriture. C’est à vrai dire un des points tout à fait essentiels, où notre penseur reconnaît au texte écrit un destin propre. Il y a, soutient-il, une signification textuelle qui n’est pas la signification mentale : « L’écriture rend le texte autonome à l’égard de l’intention de l’auteur ».
La question de la relation entre l’intention de l’auteur et l’écrit a donné lieu à des méditations qui ont marqué la philosophie du siècle dernier. Celles de Derrida en sont une illustration assez connue. Il faut pourtant savoir que Ricœur est également présent sur ce terrain avec sa thèse selon laquelle « grâce à l’écriture, le monde du texte peut faire éclater le monde de l’auteur » ! Or, du point de vue de l’herméneutique, cela signifie que l’on peut prendre congé de l’auteur : il a beau avoir apposé sa marque par son style, l’œuvre elle-même mène désormais une existence propre et le sens qu’elle donne à comprendre excède celui qu’avait voulu y mettre son auteur. C’est ce qui explique d’ailleurs que l’œuvre peut s’inscrire dans des contextes socioculturels toujours nouveaux, avec cette capacité de signifier comme si elle en était issue. L’acte de lire est justement, nous dit Ricœur, l’acte de la « recontextualiser ».
Cette rupture introduite entre l’auteur et son texte par l’écriture est ce qui permet par ailleurs de s’en prendre cette fois à une idée centrale chez Gadamer, à savoir celle de l’herméneutique comme dialogue, comme reprise du dialogue initié par l’auteur. Ce dernier ayant été évincé de l’horizon de la lecture, il n’y a plus de place pour quelque chose comme un échange… Précisons encore à ce propos que la distanciation est double ici : en même temps que l’auteur s’éclipse de notre horizon de lecteur et que nous arrachons le texte écrit de son contexte de naissance, nous poursuivons de notre côté notre démarche herméneutique qui nous dépouille de notre historicité… Mais cela apparaît encore mieux dans la suite.
Après ces considérations sur l’écriture, Ricœur enchaîne avec un passage intitulé « Le monde du texte », où il insiste sur ce phénomène d’émancipation de l’œuvre par rapport au moment de sa genèse. Il le fait en rappelant que si le discours, en tant que proposition, fait référence à la réalité, il y a une différence essentielle qui se manifeste de ce point de vue selon qu’il s’agisse de discours oral ou de discours écrit. En effet, le discours oral jouit du pouvoir de montrer la réalité à laquelle il fait référence. Cette réalité, dit Ricœur, est « commune aux interlocuteurs ». Dans le cas de l’écrit, la monstration devient impossible, car les interlocuteurs ne sont plus dans une situation commune. Mais, poursuit-il, c’est justement de cette incapacité à montrer une réalité commune que naît la littérature. La littérature, cependant, ne se contente pas de nous faire parvenir ce qu’elle peut du monde qui a présidé à la création du texte : elle… détruit ce monde ! Avec l’œuvre littéraire, dans sa diversité, la fonction référentielle est sacrifiée au profit du langage qui se trouve ainsi « glorifié ». La référence à la réalité ne disparaît pas, mais elle donne lieu désormais à un jeu de langage. Est-ce à dire que l’œuvre n’a plus aucun rapport à la réalité, après l’acte de destruction qu’elle accomplit ? Non, répond Ricœur : il y a un rapport à la réalité, mais il n’est plus du même ordre. Il se situe maintenant à un « niveau plus fondamental » ! Celui auquel font référence Husserl avec sa notion de « Lebenswelt » et Heidegger avec celle de « l’être-au-monde ».
Du texte à l’action
Tel est donc le « monde du texte » que déploie l’œuvre et qu’elle propose à l’interprétation. Par le sacrifice de la réalité à laquelle elle continue de faire référence à un premier niveau – celui du discours simplement descriptif -, elle nous met face à une réalité d’un autre ordre, qui est précisément ce qui doit occuper l’herméneutique. Ricœur le dit d’une autre manière encore : « Ce qui est à interpréter dans un texte, c’est une proposition de monde, d’un monde tel que je puisse l’habiter pour y projeter un de mes possibles les plus propres ». Formulation qui implique cette fois l’interprète et sa relation à l’œuvre comme expérience d’existence, mais qui anticipe aussi la partie finale du développement : « Se comprendre devant l’œuvre ».
La compréhension de l’œuvre, dont nous avons dit précédemment qu’elle était d’abord explication de sa structure, ne se développe complètement que dans ce dernier moment où c’est l’interprète qui se comprend lui-même face à l’œuvre. Se comprenant ainsi, il s’ouvre de nouvelles perspectives en vue de l’action, y compris sur le plan politique : d’où le titre de l’ouvrage dont nous commentons présentement un chapitre essentiel : « Du texte à l’action » ! Mais l’engagement dans l’action – celle par laquelle on change le monde -, n’est rendu possible, justement, que si on s’est exposé au monde du texte. Puisque tel est le sens de toute compréhension appliquée à l’œuvre : « non pas imposer au texte sa propre capacité finie de comprendre, mais s’exposer au texte et recevoir de lui un soi plus vaste » ! Qu’est-ce qu’un soi plus vaste ? Le même qui aurait été simplement élargi ? Non, nous dit Ricœur : il faut se perdre pour se trouver ! Et se perdre, c’est immoler le moi de sa représentation ordinaire. De la même manière que la réalité « plus fondamentale » n’advient par l’œuvre que si, au préalable, la première réalité du texte a été sacrifiée, l’interprète n’accède de son côté à la « métamorphose ludique » de son ego que s’il a accepté au préalable de se délester de sa subjectivité. Il y a une « désappropriation » de soi qui est condition d’une appropriation, d’une appropriation de soi propice à l’action… Et ces considérations nous ramènent enfin aux philosophies du soupçon – objet de notre chronique précédente -, qui ne se contentent pas d’alerter sur le risque d’une pollution de l’œuvre par l’idéologie : qui insistent également sur une « critique des illusions du sujet ». Autrement dit, le soi plus vaste qu’on découvre à la faveur de notre rencontre avec la « chose du texte », n’est pas un soi appelé à s’installer à demeure comme une évidence, parce que le discours idéologique et ses préjugés voudraient qu’il en soit ainsi. C’est un soi qui reste ouvert aux possibles qu’il porte en lui.
Que conclure au sujet de cette « voie longue » que nous avons suivie avec Ricœur ? Qu’elle est assurément très différente de ce que Gadamer propose à travers sa critique de la « distanciation aliénante ». Toutefois, il ne devrait pas nous échapper qu’avec l’un et l’autre penseur, il est question d’une relation au langage qui est portée à un haut degré de fécondité… Il nous faudra y revenir !